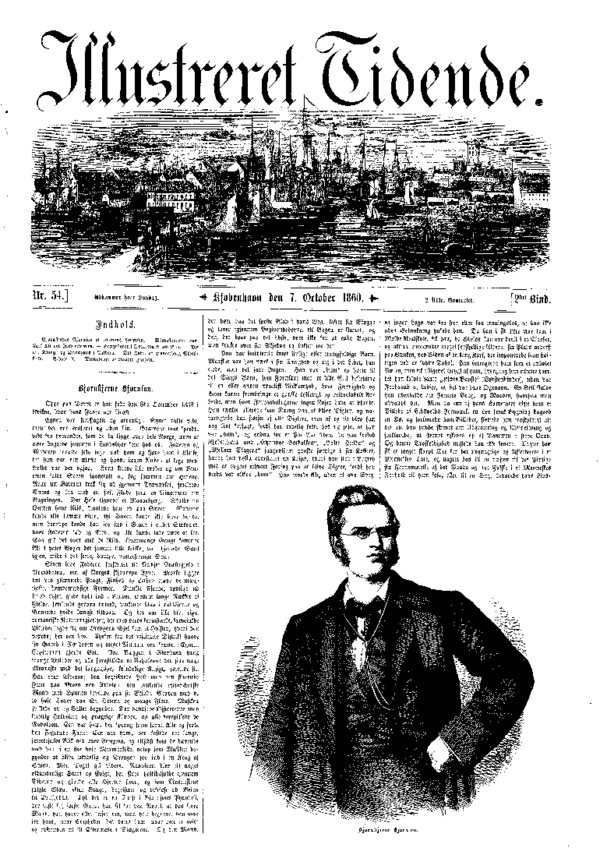Appel à Contributions : Traduire la littérature de l’Europe du Nord à l’ère technologique (Deshima 2026)
[English below]
Appel à communications – Deshima n°20 (2026)
Traduire la littérature de l’Europe du Nord à l’ère technologique : reconfigurations culturelles, enjeux politiques et mutations professionnelles
Le monde de la traduction et de la littérature traverse actuellement une phase de profonds bouleversements. Ces évolutions remettent en question des méthodologies bien établies, des hiérarchies institutionnelles, des pratiques professionnelles, mais aussi des imaginaires culturels et littéraires. Elles affectent également les formations universitaires et les modes de circulation des textes, redessinant les contours du champ littéraire mondial.
Pour une revue comme Deshima, consacrée aux relations culturelles, littéraires et linguistiques entre l’Europe du Nord et le monde francophone, il nous semble essentiel, à la veille de son vingtième anniversaire, de consacrer un numéro thématique à la traduction, à l’orée de ces transformations. L’objectif est d’étudier comment des voix issues d’aires linguistiques et géographiques moins dominantes – en raison d’un nombre de locuteurs modeste ou d’un manque de visibilité dans les circuits dominants de la traduction – ont su se faire entendre et d’évaluer ce que peut modifier l’évolution des pratiques traductives.
Ce numéro souhaite notamment mettre en lumière les liens entre les littératures du Nord et du Sud, que ce soit à travers des réseaux historiques de traduction, des logiques d’asymétrie linguistique, ou des circulations indirectes par le biais de langues intermédiaires (comme le français ou l’anglais). Il s’agit aussi d’interroger les écarts – mais aussi les zones d’échange – entre « grandes » et « petites » langues, entre aires centrales et périphériques, entre pratiques traditionnelles et défis liés à l’émergence de nouvelles technologies.
Pour son 20ᵉ numéro, Deshima lance donc un appel à contributions sur le thème de la traduction littéraire, envisagée à la fois comme pratique textuelle, enjeu culturel, réalité socio-économique et objet politique. Les propositions pourront s’inscrire dans une perspective synchronique (études de cas contemporains, état des lieux actuels) ou diachronique (histoire des pratiques et des institutions de traduction).
Voici quelques axes thématiques possibles (liste non exhaustive) :
- Corpus traduit. Quel·le·s auteur·e·s et quelles œuvres sont traduits ? Qui est canonisé à travers la traduction ? Certains pays sont-ils sous-représentés ? Certains genres sont-ils davantage traduits (roman, polar, jeunesse, etc.) ?
- Traducteur·ices. Qui traduit ? Traduisent-ils/elles de plusieurs langues ? Quel est le rôle du genre, de la formation ou du statut professionnel dans cette activité ?
- Édition et publication. Quel·le·s maisons d’édition, collections ou réseaux éditoriaux structurent le champ de la traduction littéraire ?
- Institutions et politiques. Quelles structures (États, fondations, programmes européens, etc.) soutiennent ou orientent les politiques de traduction ?
- Réception. Quelle est la visibilité des traductions dans la critique littéraire, la presse, les médias spécialisés ? Comment les traductions du Nord sont-elles reçues dans les espaces francophones (et inversement) ?
- Aspects linguistiques et stylistiques. Quels défis posent les structures grammaticales, la syntaxe ou la prosodie des langues du Nord dans la traduction littéraire ?
- Paratextes et stratégies éditoriales. Quelle place occupent les préfaces, notes, choix typographiques ou stratégies éditoriales dans l’accueil des traductions ?
- Étrangéisation vs. domestication. Les traductions valorisent-elles l’« exotisme » de la culture source, ou cherchent-elles à l’effacer au profit d’une lecture qui rend les œuvres plus familières au lectorat cible ?
- Traductions indirectes (ou relais). Quel rôle le français joue-t-il comme langue de passage ? Certaines œuvres du Nord sont-elles traduites à partir de l’allemand, de l’anglais ou d’une autre langue ?
- Traduction humaine vs. automatique. Comment les traducteurs littéraires du Nord (et d’ailleurs) perçoivent-ils les avancées de la traduction neuronale ? Quels débats ont cours dans ces milieux ?
Dans la revue Deshima, une attention particulière est portée aux langues nationales de la Scandinavie (et au finnois, à l’islandais, etc.), ainsi qu’au néerlandais. Le comité de rédaction encourage également les propositions portant sur des langues moins diffusées (comme le frison ou d’autres langues nordiques minorées), ou sur des espaces géographiques historiquement connectés à l’Europe du Nord.
Les études comparatives, les analyses de traductions vers d’autres langues que le français, ou encore les travaux sur les dynamiques croisées de traduction (via le français, ou entre espaces culturels) seront également les bienvenus, pourvu qu’un lien explicite soit établi avec la sphère francophone.
Modalités de soumission
Les propositions devront être envoyées à Roberto Dagnino (dagnino@unistra.fr) et Cyrille François (cyrille.francois@unil.ch) avant le 15 septembre 2025. Elles comprendront :
- un titre ;
- un résumé de 200 à 300 mots ;
- 5 mots-clés ;
- une courte notice biographique (5-6 lignes).
Une réponse sera transmise aux auteur·e·s début octobre. Les articles complets seront attendus pour le 31 janvier 2026. Après évaluation en double aveugle, les textes acceptés seront publiés dans le numéro de novembre 2026.
Lire la suite : Appel à Contributions : Traduire la littérature de l’Europe du Nord à l’ère technologique (Deshima 2026)Call for Papers – Deshima No. 20 (2026)
Translating Northern European Literature in the Digital Era: Cultural Reconfigurations, Political Stakes, and Professional Transformations
The fields of translation and literature are currently undergoing profound transformations. These developments are challenging well-established methodologies, institutional hierarchies, professional practices, as well as cultural and literary imaginaries. They also impact university curricula and the modes through which texts circulate, thereby reshaping the contours of the global literary landscape.
For a journal like Deshima, devoted to the cultural, literary, and linguistic relations between Northern Europe and the Francophone world, it seems essential—on the eve of its twentieth anniversary—to dedicate a thematic issue to translation in the context of these transformations. The objective is to examine how voices emerging from less dominant linguistic and geographical areas—whether due to a smaller number of speakers or a lack of visibility in the dominant translation circuits—have managed to make themselves heard, and to assess the extent to which evolving translation practices are contributing to this shift.
This issue aims in particular to shed light on the connections between Northern and Southern literatures, whether through historical translation networks, dynamics of linguistic asymmetry, or indirect circulations via intermediary languages (such as French or English). It also seeks to explore the gaps—and the exchange zones—between “major” and “minor” languages, between central and peripheral regions, and between traditional practices and the challenges arising from new technologies.
For its 20th issue, Deshima is therefore launching a call for contributions on the theme of literary translation, considered as a textual practice, a cultural stake, a socio-economic reality, and a political object. Contributions may adopt a synchronic perspective (case studies of the present day, current overviews) or a diachronic one (historical studies of translation practices and institutions).
Possible thematic axes include (non-exhaustive list):
- Translated corpus. Which authors and works are being translated? Who is canonised through translation? Are certain countries under-represented? Are some genres more frequently translated (novels, crime fiction, children’s literature, etc.)?
- Translators. Who translates? Do they work from multiple languages? What role does gender, training, or professional status play in this activity?
- Publishing and distribution. Which publishing houses, series, or editorial networks structure the field of literary translation?
- Institutions and policies. Which institutions (States, foundations, European programmes, etc.) support or influence translation policies?
- Reception. What visibility do translations have in literary criticism, the press, and specialist media? How are translations from the North received in Francophone contexts (and vice versa)?
- Linguistic and stylistic aspects. What challenges are posed by the grammar, syntax, or prosody of Northern languages in literary translation?
- Paratexts and editorial strategies. What role is played by prefaces, notes, typographical choices, or editorial strategies in the reception of translations?
- Foreignisation vs. domestication. Do translations highlight the “exoticism” of the source culture, or do they seek to erase it in favour of a reading experience more familiar to the target audience?
- Indirect (relay) translations. What role does French play as a bridge language? Are some works from the North translated via German, English, or another language?
- Human vs. machine translation. How do literary translators in the North (and elsewhere) perceive the advances in neural translation? What debates are taking place in these circles?
In the journal Deshima, special attention is given to the national languages of Scandinavia (and to Finnish, Icelandic, etc.), as well as Dutch. The editorial board also encourages proposals concerning lesser-used languages (such as Frisian or other minoritised Nordic languages), or on geographical areas historically connected to Northern Europe.
Comparative studies, analyses of translations into languages other than French, or research on cross-translation dynamics (via French, or between cultural spaces) are also welcome, provided a clear link is established with the Francophone sphere.
Submission Guidelines
Proposals must be sent to Roberto Dagnino (dagnino@unistra.fr) and Cyrille François (cyrille.francois@unil.ch) by 15 September 2025. They should include:
• a title;
• an abstract of 200 to 300 words;
• 5 keywords;
• a short biographical note (5–6 lines).
Authors will receive a response in early October. Complete articles will be expected by 31 January 2026. Following double-blind peer review, accepted texts will be published in the November 2026 issue.